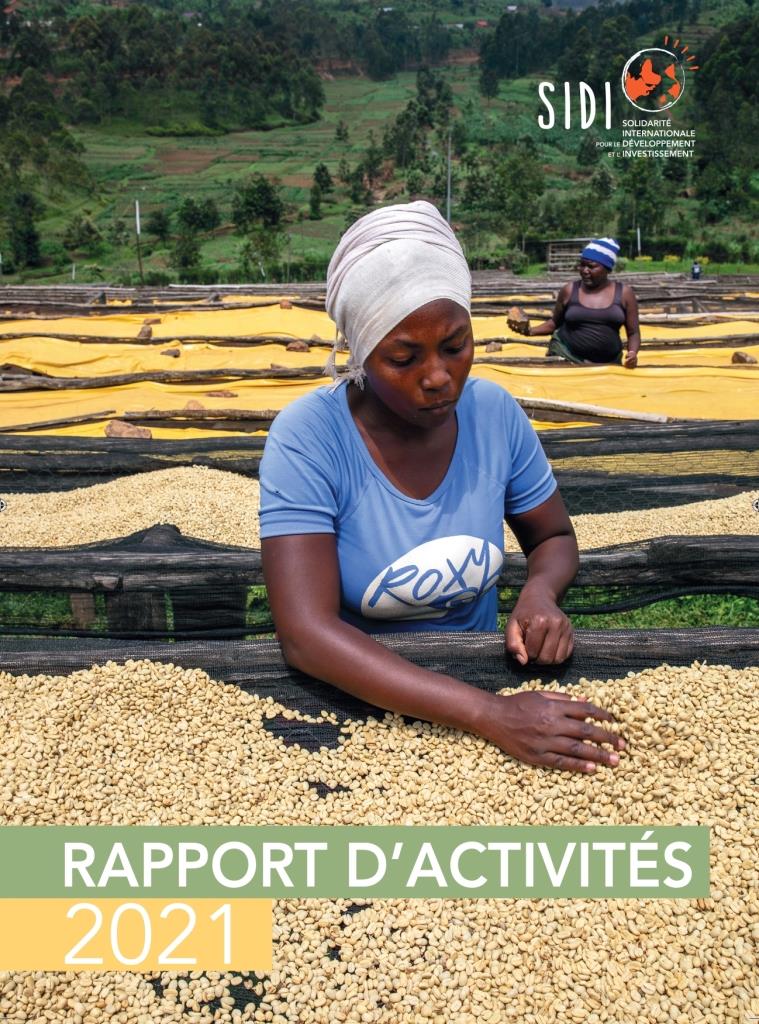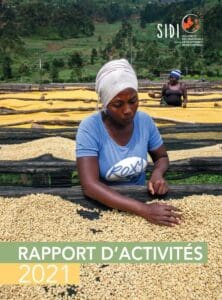Retour de mission : chaque trimestre, un membre de l’équipe opérationnelle de la SIDI nous partage une mission réalisée auprès des partenaires et de leurs bénéficiaires.
Avez-vous remarqué l’envolée du prix de votre chocolat préféré ces derniers temps ? La hausse des cours représente de nombreux défis pour nos partenaires impliqués dans la filière cacao en Côte d’Ivoire, un pays qui représente à lui seul près de 40% de la production mondiale. De retour de mission, Junior Tombe, chargé de partenariats, nous apporte son éclairage.
Depuis septembre 2023, je suis en charge du suivi des partenaires de la SIDI dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. C’est ainsi que j’ai découvert la Côte-d’Ivoire, un des pays d’intervention de la SIDI. Les mutations que connait le secteur agricole dans ce pays rendent chaque mission passionnante.
Cette fois-ci ma mission concernait la filière cacao. Nous accompagnons principalement des coopératives certifiées qui achètent directement aux producteurs des fèves séchées et fermentées et revendent ensuite aux exportateurs, souvent filiales des grandes multinationales du chocolat.
Il faut savoir qu’aujourd’hui la Côte-d’Ivoire représente entre 35 à 40% de la production mondiale de cacao (plus de 50% avec le Ghana). Toute évolution de la production y influence donc directement le marché mondial.
La vente à terme du cacao face à l’envol des cours mondiaux
La particularité intéressante de la Côte-d’Ivoire est d’avoir un marché du cacao très encadré. L’État, à travers le Conseil Café Cacao (CCC) fixe le prix du cacao à chaque début de campagne : du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante pour la grande traite, et du 1er avril au 30 septembre pour la petite traite. Ainsi, un barème de prix définit le prix de vente à tous les niveaux de la chaîne de commercialisation, du planteur à l’exportateur. Le prix « bord champ » est celui payé aux producteurs par les coopératives. En principe, nul ne peut acheter en dessous ou au-dessus sous peine de sanctions.
Cette politique de stabilisation des prix, adoptée après les excès constatés de la libéralisation, garantit un prix minimum aux producteurs et permet de sécuriser les ventes futures via des contrats à terme, à des prix négociés six-douze mois avant la campagne. Mais la dernière campagne (2023/24) et la grande traite de la campagne 2024/25 ont été marquées par une baisse de la production : moins 25 à 30% en 2023-2024 et baisse des livraisons pour la campagne en cours. Causée par le dérèglement climatique -les « sécheresses » alternent avec des trop fortes pluies -, la baisse de la production couplée à la spéculation boursière a contribué à la flambée historique des cours sur le marché international (la tonne de cacao passait de 4k$ à 12k$ entre fin 2023 et avril 2024).
Étant donné que la grande partie de la production de cacao ivoirien est vendue anticipativement à des prix négociés à l’avance, la flambée des prix a donc creusé l’écart entre le prix bord champs payé aux producteurs et le prix sur le marché, mettant finalement en tension la politique de stabilisation des prix. Cela pose de nouveaux défis aux coopératives.
Des partenaires matures capables d’anticiper les évolutions de la production
J’ai été impressionné lors de ma mission par la maturité de nos coopératives partenaires face à ces défis. Elles ont ainsi réussi à livrer 80% de leurs contrats aux acheteurs sur la grande traite 2024/25.
Cela démontre leur niveau de connaissance du terrain ainsi que l’efficacité de leurs stratégies de fidélisation des producteurs. Dans un contexte de baisse de production du cacao pouvant intensifier la concurrence, les avantages que nos partenaires fournissent à leurs membres sont déterminants pour sécuriser le stock : fourniture d’intrants, prêts scolaires, formations, dons d’outils, etc.
En plus d’avoir misé sur les services non commerciaux, nos partenaires ont anticipé l’augmentation de leur besoin de financement. C’est ainsi qu’ils ont obtenu des montants plus importants de préfinancements des acheteurs, en plus du relèvement des montants de leurs prêts négociés à la SIDI (+1,1 M€ de prêts en 2024 par rapport à 2023).
Contrairement aux avances des acheteurs, remboursées à la livraison et aux prêts des banques souvent amortis mensuellement, les prêts SIDI offrent un fonds de roulement flexible car ils sont remboursés sur les dernières livraisons.
L’exemple d’ECAM, un partenaire emblématique de la SIDI depuis 2017
Basée à Méagui au sud-est de la Côte d’Ivoire, ECAM dépasse les 3000 membres pour une capacité de production d’environ 7000 t de cacao.
Lors de ma visite dans les plantations de membres d’ECAM, je me suis rendu compte de la résilience de la coopérative car certaines parcelles sont touchées par la maladie swollen shoot depuis quelques années. Cette maladie, incurable à ce jour, détruit les branches et les feuilles des cacaoyers, entrainant la chute de la production pour les producteurs et par conséquent, la baisse des revenus. Pour faire face à ce fléau, ECAM promeut la diversification des cultures en distribuant des semences des cultures maraichères pour suppléer le cacao dans les zones infectées. Ceci s’ajoute aux activités du programme de durabilité d’ECAM: la promotion des intrants bio pour soutenir la productivité, distribution d’arbres d’ombrage etc.
SCEB, une coopérative 100% bio qui pourrait être un nouveau partenaire
Cette mission m’a permis de rencontrer un potentiel nouveau partenaire pour la SIDI : SCEB, une coopérative 100% bio, assez différente de ce qu’on peut voir en Côte-d’Ivoire.
Pour la SIDI, c’est important de soutenir un partenaire qui fait le choix de l’agriculture biologique dans un contexte où moins de 10% des membres des coopératives partenaires sont bio, et où l’Union Européenne, principale acheteuse du cacao ivoirien, renforce ses dispositifs légaux de lutte contre la déforestation.
Le positionnement de la coopérative sur ce marché de niche dans un pays qui cultive presque exclusivement le cacao en conventionnel constitue un exemple pour d’autres coopératives.
Dans l’ensemble, c’est vraiment enrichissant pour la SIDI d’accompagner ces partenaires de la filière cacao en Côte d’Ivoire qui montrent une grande capacité d’adaptation. Ainsi, je suis convaincu que l’expérience ivoirienne peut être riche d’enseignements pour d’autres pays et d’autres filières.
Propos recueillis par Anne-Isabelle Barthélémy
Crédits images SIDI : plants de cacao, pépinière d’arbres d’ombrage, sur la route, cacaoyer atteint par le swollen shoot